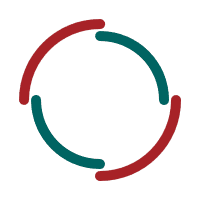Classification
- ClasseInsecta
- OrdreLepidoptera
- FamilleNymphalidae
- GenreCoenonympha
- Espècearcania
- Nom scientifiqueCoenonympha arcania
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Envergure : 28-35 mm
Il n’existe que peu de risques de confusion avec les autres Fadets, même si la littérature mentionne quelques cas d’hybridation avec le Mélitée (Coenonympha hero). Le Céphale se pose toujours les ailes relevées, et l’on reconnaît alors la large bande postmédiane blanche caractéristique des ailes postérieures, flanquée d’une série d’ocelles, dont trois nettement plus grands. Le Céphale pourrait être confondu avec le Fadet de la Mélique, mais chez celui-ci, la bande blanche est moins importante ; en outre, ce dernier paraît plus sombre et terne en vol.
Habitat
Le Céphale est un Fadet mésophile préférant le calcaire, les bois clairs, les ourlets, les biotopes bien exposés mais toujours pourvus d’une importante strate arbustive. Il longe les buissons et s’y pose le plus souvent. Les chenilles consomment les feuilles de diverses Poacées (Méliques, Brachypodes, Fétuques…), comme celles de tous les Satyrines.
Reproduction
Espèce univoltine volant essentiellement de la fin mai à la fin juin, des individus tardifs de Céphale sont possibles en juillet. Dans les environs de Dijon et de Vesoul, quelques rares individus appartenant à une deuxième génération partielle sont parfois observés en fin d’été (cycle rapide et émergence précoce).
Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent principalement du nectar des fleurs, les chenilles dévorent les plantes hôtes.
Relation avec l’homme
Le Céphale requiert une strate arbustive importante, notamment en lisières. La gestion forestière en futaie régulière lui est préjudiciable. Cette espèce ne semble pas menacée, mais ses densités sont bien moins importantes que par le passé ; elle évite de nombreuses zones, notamment en plaine. Son cas illustre parfaitement l’intérêt de conserver des massifs de buissons sur les pâturages où les fauches d’entretien sont de plus en plus régulières et conduisent à l’élimination systématique de toute strate arbustive. Le statut du Céphale n’est pas préoccupant actuellement, même s’il est moins répandu qu’autrefois. Les principales mesures reposent sur la conservation de forêts anciennes claires, de lisières ensoleillées et de haies hautes. Dans les systèmes pâturés, notamment les pelouses sèches, le maintien de bouquets de buissons bien contenus s’avère très favorable, permettant au passage à de nombreux autres papillons de prospérer.
Réseau trophique
Les papillons sont les proies de nombreux insectivores, ils peuvent être consommés par d’autres insectes et des oiseaux par exemple.
Répartition géographique
Le Céphale est une espèce holoméditerranéenne, en régression modérée dans une bonne partie de la France. Elle est présente partout en Franche-Comté sauf en zone montagneuse ; en Bourgogne, elle est fréquente dans toutes les régions naturelles de Côte-d’Or mais rare hors des zones calcaires accidentées : elle manque particulièrement en plaine de Saône (Bresse), dans le Brionnais, le Charolais, le Bazois et la Puisaye. Elle reste très localisée et en faible densité dans les placettes bien exposées du Morvan et de l’Autunois.