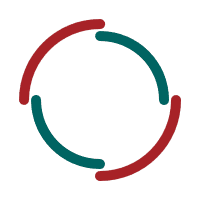Classification
- ClasseInsecta
- OrdreLepidoptera
- FamilleNymphalidae
- GenreBrenthis
- Espèceino
- Nom scientifiqueBrenthis ino
Cartes, phénologie, nombre de données, etc...
Carte de l'espèce
Morphologie
Envergure : 32-40 mm
Les individus des deux sexes de Brenthis ino sont très proches : dessus fauve orangé orné de macules noires et d’une bordure marginale continue, dessous de l’aile postérieure marqué de taches variant du jaune au rouge brique dans la partie basale et brun violacé au-delà de l’aire médiane. La femelle est parfois assombrie. Le Nacré de la Sanguisorbe ressemble au Nacré de la Ronce (Brenthis daphne), mais ce dernier est plus grand, plus arrondi, avec le revers des postérieures plus violacé. La confusion reste néanmoins possible avec certains sujets de B. daphne atypiques et usés.
Habitat
Le Nacré de la Sanguisorbe, hygrophile, affectionne les prairies humides, y compris les prairies de fauche, les bords de rivières, de marécages et d’étangs, les clairières et les chemins forestiers et même les pourtours des tourbières. Quelques mètres carrés suffisent à l’établissement d’une petite colonie qui peut parfois jouxter une route, une zone industrielle ou commerciale. Des individus erratiques ont été observés loin d’un biotope favorable. Les adultes butinent nombre de plantes nectarifères (Trèfles, Renoncules, Scabieuses, Cirses, Succise…) et se reposent souvent ailes ouvertes au soleil. La chenille se développe sur la Reine-des-prés (Filipendula ulmaria) et probablement sur les Sanguisorbes (Sanguisorba minor et S. officinalis) dans certains secteurs d’altitude. Il est beaucoup moins commun et plus menacé que le Nacré de la ronce qui fréquente des plantes hôtes différentes, cependant les mosaïques de milieux sont parfois favorables à les voir voler ensemble.
Reproduction
Cette espèce vole en une génération surtout groupée en juin-juillet.
Régime alimentaire
Les adultes se nourrissent principalement du nectar des fleurs, les chenilles dévorent les plantes hôtes.
Relation avec l’homme
Bien qu’elle soit capable de subsister dans des milieux de faible superficie comme des abords de fossés agricoles, cette espèce est fortement impactée par la modification de son habitat, qui tend à subir un morcellement généralisé. Les atteintes portées aux zones humides et plus particulièrement aux mégaphorbiaies à Filipendule lui sont néfastes. Ces formations végétales, souvent réduites, tendent en effet à être trop systématiquement détruites en vue d’une valorisation fourragère (retournement, fauches répétées et précoces, amendements…). Aujourd’hui, le Nacré de la Sanguisorbe est considéré comme quasi menacé par la Liste Rouge régionale de l’UICN. Les populations du Nacré de la Sanguisorbe sont parfois importantes dans les biotopes favorables. L’évolution des milieux humides de plaine laisse redouter une future modification de statut. Ce papillon présente la capacité de se maintenir sur de petites surfaces, ce qui lui permet de reconquérir rapidement des espaces favorables à partir de stations-refuges. La conservation de réseaux de prairies humides par pâturage extensif ou fauche tardive s’avère en ce sens indispensable, tout comme le maintien des micro-zones humides distribuées à la faveur de dépressions le long des petits cours d’eau, suintements et autres ruisselets.
Réseau trophique
Les papillons sont les proies de nombreux insectivores, ils peuvent être consommés par d’autres insectes et des oiseaux par exemple.
Répartition géographique
C’est une espèce eurasiatique. En France, elle est présente surtout dans le Nord-Est, mais manque dans la plupart des départements de l’Ouest. Elle est bien répandue sur la retombée méridionale des Vosges qui recèle de nombreux biotopes favorables, depuis la chaume du Ballon de Servance (1 216 m) jusqu’à basse altitude (185 m) le long des affluents de la Saône. Dans l’arc jurassien, elle monte en altitude jusqu’à 1 485 m (Jura : Crêt Pela). En Bourgogne, l’espèce est bien représentée dans le Morvan, le Bazois et le Châtillonnais. Dans le département de l’Yonne, elle est très peu représentée et se raréfie quasiment partout.